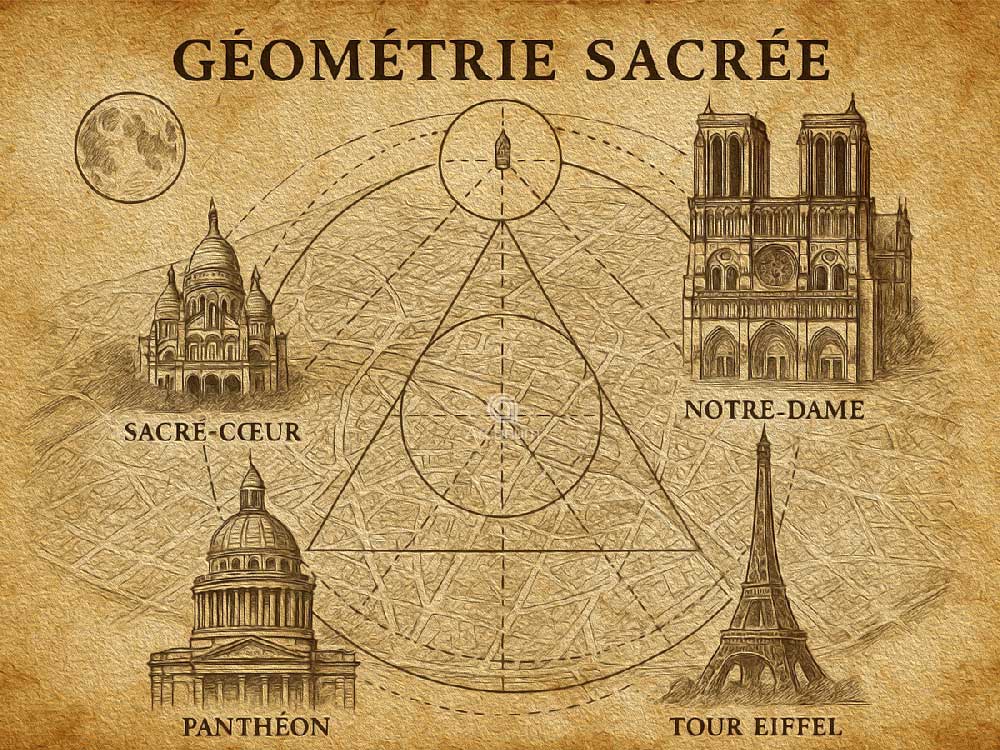RECEVEZ GRATUITEMENT NOS HISTOIRES
DU PARIS INSOLITE & SECRET
LE MAG’ DU PARIS SECRET
Les plus belles histoires insolites de Paris




La construction de la Statue de la Liberté à Paris
L'Histoire insolite et les secrets de la construction de la Statue de la Liberté
Il est des histoires qui semblent avoir été écrites pour défier l’oubli, pour s’insinuer dans les recoins de la mémoire collective et y déposer leur lot de mystères, de légendes et de vérités cachées. L'histoire de la statue de la Liberté, colosse de cuivre et d’acier, en est l’exemple parfait. Si aujourd’hui elle trône fièrement à l’entrée du port de New York, accueillant des millions de visiteurs chaque année, peu savent que c’est à Paris, au cœur du 17e arrondissement, que cette icône mondiale a vu le jour. Derrière son visage serein et sa torche levée, la statue de la Liberté recèle une histoire fascinante, tissée de rêves, de luttes, d’innovations et de secrets. Voici le récit de sa création, tel que vous ne l’avez jamais lu.
Paris, berceau d’un rêve américain

Tout commence dans l’effervescence intellectuelle de la France du XIXe siècle. Nous sommes en 1865, la guerre de Sécession s’est achevée aux États-Unis, Abraham Lincoln vient d'être assassiné, laissant derrière lui un pays meurtri mais résolu à défendre les valeurs de liberté et d’égalité. Dans les salons feutrés de Paris, Édouard de Laboulaye, juriste, académicien et ardent défenseur de la démocratie, imagine un geste d’amitié aussi audacieux que symbolique : offrir aux Américains une statue monumentale pour célébrer le centenaire de leur indépendance, mais aussi pour sceller l’alliance entre la France et la jeune république d’outre-Atlantique.
Laboulaye n’est pas un homme à se satisfaire de demi-mesures. Pour lui, la statue doit incarner la victoire de la liberté sur l’oppression, rendre hommage à l’abolition de l’esclavage, et rappeler au monde que la France, malgré ses propres contradictions, demeure la patrie des Lumières. Mais comment donner corps à une telle ambition ? C’est là qu’entre en scène un jeune sculpteur au regard de feu, Frédéric Auguste Bartholdi, recruté par Laboulaye. Peu après, la fondation "Union Franco-Américaine" est créée afin de récolter les premiers fonds qui permettront de débuter ce projet titanesque.
Le sculpteur et l’utopie
 Bartholdi, né à Colmar en 1834, n’est pas un inconnu. Il a déjà signé quelques monuments remarqués, mais rêve de s’inscrire dans la lignée des grands bâtisseurs de l’histoire. L’idée d’un colosse moderne, digne héritier du colosse de Rhodes, le fascine. Dès 1870, il façonne une première ébauche de la statue en terre cuite, aujourd’hui précieusement conservée au musée des Beaux-Arts de Lyon. Mais le chemin qui mène de la maquette à la réalité s’annonce semé d’embûches.
Bartholdi, né à Colmar en 1834, n’est pas un inconnu. Il a déjà signé quelques monuments remarqués, mais rêve de s’inscrire dans la lignée des grands bâtisseurs de l’histoire. L’idée d’un colosse moderne, digne héritier du colosse de Rhodes, le fascine. Dès 1870, il façonne une première ébauche de la statue en terre cuite, aujourd’hui précieusement conservée au musée des Beaux-Arts de Lyon. Mais le chemin qui mène de la maquette à la réalité s’annonce semé d’embûches.
En 1871, Bartholdi entreprend un voyage aux États-Unis pour présenter le projet et trouver des soutiens financiers. Il arpente New York, scrute la rade, et repère l’île de Bedloe, un îlot désert à l’entrée du port, qu’il imagine déjà couronné par la silhouette de la Liberté. Mais l’Amérique, alors en pleine reconstruction, n’a ni le temps ni l’argent à consacrer à une telle entreprise. Qu’à cela ne tienne : Bartholdi rentre à Paris, bien décidé à faire naître son rêve dans la capitale française.
La rue de Chazelles, théâtre d’une épopée

C’est au 25 rue de Chazelles, dans le 17e arrondissement, que le miracle va s’accomplir. Les ateliers de la cuivrerie d’art Gaget, Gauthier et Compagnie, réputés pour leur savoir-faire, deviennent le laboratoire secret de la statue de la Liberté. Les Parisiens, intrigués, voient bientôt s’élever au-dessus des toits la silhouette d’une femme géante, dont la tête et la main dépassent les immeubles de la plaine Monceau. On chuchote, on s’interroge : qui est donc cette mystérieuse dame de cuivre qui grandit chaque jour un peu plus ?

La construction de la statue est un défi technique sans précédent. Pour donner forme à ce géant de 46 mètres de haut, Bartholdi s’entoure des meilleurs ingénieurs. Eugène Viollet-le-Duc, architecte visionnaire ayant déjà rénové la cathédrale de Notre-Dame de Paris, conçoit la structure de la main et du flambeau, premiers éléments achevés et exposés à Philadelphie lors de l’Exposition universelle de 1876. Les visiteurs, fascinés, paient 50 cents pour grimper jusqu’au balcon de la torche, finançant ainsi le projet.

Mais le destin frappe : Viollet-le-Duc meurt en 1879. C’est alors Gustave Eiffel, futur père de la tour éponyme, qui reprend le flambeau. Il imagine une armature métallique révolutionnaire, souple et résistante, capable de supporter les 300 plaques de cuivre martelées qui composent la carapace statue. Chaque élément de la Statue de la Liberté est assemblé, démonté, puis remonté, dans une chorégraphie d’une précision extrême.
Secrets d’atelier et prouesses techniques
La création de la statue de la Liberté est une aventure humaine autant qu’industrielle. Dans les ateliers de la rue de Chazelles, le bruit des marteaux sur le cuivre résonne jour et nuit. Les ouvriers façonnent, ajustent, rivent, sous l’œil attentif de Bartholdi. Pour chaque partie de la statue, un modèle en plâtre est réalisé, puis recouvert de gabarits en bois, qui servent de moules pour le martelage des plaques de cuivre, d’une épaisseur de 1 à 3 mm.

Le choix du cuivre, plus léger que le bronze, s’impose pour des raisons de solidité et de maniabilité. L’armature métallique, conçue par Eiffel, est pensée pour résister aux vents violents de la baie de New York, tout en permettant à la statue de se dilater et de se contracter au gré des variations de température. Un véritable tour de force, qui préfigure les grandes réalisations du XXe siècle.

Au fil des mois, la statue prend forme. Sa tête, dévoilée lors de L'exposition universelle de Paris en 1878 sur le Champ-de-Mars, devient l’une des attractions majeures de la capitale. Les visiteurs peuvent pénétrer dans la tête jusqu’au diadème, gravir un escalier de 43 mètres et contempler Paris à travers les yeux de la Liberté. La main tenant le flambeau, quant à elle, voyage jusqu’à New York, où elle est exposée à Madison Square de 1877 à 1883.
Financement, polémiques et solidarité transatlantique
La contruction de la statue de la Liberté est aussi une aventure financière et politique. Si la France prend en charge le coût de la statue elle-même, le financement du piédestal, gigantesque socle de béton recouvert de granit, revient aux Américains. Mais les fonds tardent à être réunis, et le projet menace de sombrer.

C’est alors qu’intervient Joseph Pulitzer, magnat de la presse et ancien immigrant. Dans son journal « The World », il lance une vaste campagne de souscription, appelant chaque Américain à contribuer, même modestement, à la construction du piédestal. Son appel rencontre un écho sans précédent : des milliers de dons affluent, venant de toutes les classes sociales. La statue de la Liberté devient ainsi, avant même d’être érigée, le symbole d’une nation unie dans la diversité.
La poétesse Emma Lazarus, elle aussi issue de l’immigration, compose pour l’occasion son célèbre poème « The New Colossus », gravé à jamais sur le socle de la statue. Ses vers résonnent comme une promesse d’accueil et d’espoir pour tous les exilés du monde : « Donnez-moi vos pauvres, vos masses blotties aspirant à respirer librement… ».

La construction du socle, de "Miss Liberty" est confiée à l’architecte Richard Morris-Hunt qui s’inspire du socle du phare d'Alexandrie !
Fin de la construction le grand voyage vers New York
Le 24 octobre 1881, M. Morton ambassadeur des États-Unis à Paris, est invité dans les ateliers Gaget et Gauthier, pour poser le premier rivet devant servir à réunir la statue à son socle. Mais il faut attendre l'hiver 1884 pour que l'assemblage de la structure métallique de la Statue de la Liberté soit achevée. Après deux ans et huit mois de dur labeur : les badauds voient enfin s'élever le colosse au-dessus des toits du 17e arrondissement.

Il reste à la faire voyager aux Etats Unis, et ce n’est pas une mince affaire ! Haute de 46 mètres, pesant 225 tonnes, elle doit être démontée en 350 pièces, répartis dans 210 caisses, dont 36 pour les rivets et boulons. Le démontage, confié à une équipe d’ouvriers dirigée par M. Bouquet, prend plusieurs mois. Chaque pièce est soigneusement numérotée, emballée, puis acheminée en train depuis la gare Saint-Lazare jusqu’à Rouen, où la frégate française l’Isère attend son précieux chargement.
Le 21 mai 1885, l’Isère quitte Rouen, cap sur New York. La traversée de l’Atlantique est mouvementée : tempêtes, avaries, suspense… Mais le navire tient bon et arrive à destination le 19 juin, accuilli en fanfare par une armada de bateaux de tourisme.

Il faudra près d’un mois pour débarquer les caisses sur l’île de Bedloe, rebaptisée depuis Liberty Island. La statue, démontée, attendra encore plusieurs mois le temps que le piédestal soit achevé.
L’assemblage et l’inauguration : naissance d’une icône
L’assemblage de la statue sur son socle est une opération titanesque. Les ouvriers, guidés par les plans minutieux de Bartholdi et Eiffel, remontent chaque pièce avec une précision d’orfèvre.

Le 28 octobre 1886, la statue de la Liberté est enfin inaugurée, en présence du président Grover Cleveland et d’une délégation française. Les festivités sont grandioses : fanfares, feux d’artifice, défilés militaires et civils. Bartholdi, très ému, prononce ces mots : « Le rêve de mon existence est accompli. »

Mais la statue, tournée vers l’Est, semble regarder au-delà de l’océan, vers la France et la rue de Chazelles, son berceau parisien. Elle devient aussitôt le symbole de la liberté, de l’espoir et de l’accueil pour des générations d’immigrants venus chercher une vie meilleure sur les rives de l’Amérique.
Les symboles méconnus de la statue
Mais la Statue de la Liberté n’est pas qu’un exploit d’ingénierie. Elle est aussi un concentré de symboles, chaque détail ayant été minutieusement pensé par Bartholdi et ses mécènes. Sa couronne, ornée de sept rayons, représente les sept continents et les sept océans du monde, affirmant la vocation universelle de la Liberté.

La tablette qu’elle tient dans sa main gauche porte la date du 4 juillet 1776, jour de la Déclaration d’indépendance des États-Unis.

À ses pieds, des chaînes brisées rappellent la fin de l’esclavage, un message d’émancipation et de justice sociale qui résonne particulièrement dans l’Amérique post-guerre de Sécession. La torche, recouverte de feuilles d’or, devait initialement servir de phare pour guider les navires entrant dans le port de New York. Aujourd’hui, la torche d’origine est exposée dans le musée de la statue, tandis qu’une nouvelle torche, installée en 1986, continue d’illuminer l’horizon.

La statue elle-même est inspirée des déesses antiques, notamment Libertas, incarnation romaine de la liberté. Sa robe flottante, son pied levé, tout en elle exprime le mouvement, la marche en avant, l’espoir d’un avenir meilleur. Lors de son inauguration, Bartholdi déclare d'ailleurs : « Mon américaine ne conquiert pas avec des armes. La vraie Liberté triomphe par la Vérité, la Justice et la Loi. ».
Quant à la couleur de la statue, ce vert-de-gris caractéristique, est le fruit de l’oxydation naturelle du cuivre, un phénomène qui lui confère une patine unique et intemporelle.
Les répliques parisiennes : la Liberté veille sur la Seine
Si la statue de la Liberté a quitté Paris pour New York, elle n’a jamais vraiment quitté le cœur des Parisiens. Plusieurs répliques, disséminées à Paris, perpétuent son souvenir et témoignent de l’attachement des Français à ce symbole universel.
La plus célèbre se dresse à l’extrémité aval de l’île aux Cygnes, près du pont de Grenelle. Haute de 11,5 mètres, elle fut installée en 1889, lors du centenaire de la Révolution française, et fait face à New York depuis 1937. Son transfert fut une aventure rocambolesque : posée sur un plancher, elle fut glissée à l’aide d’un treuil et d’un rouleau compresseur, sous les regards émerveillés des Parisiens.

Une autre réplique, en bronze, veille sur le musée d’Orsay, tandis que la maquette originale en plâtre, réalisée par Bartholdi en 1878, trône dans l’église du musée des Arts et Métiers. Depuis 2010, une copie en bronze accueille les visiteurs dans le jardin du musée.
Enfin, la Flamme de la Liberté, réplique de la torche, illumine la place de l’Alma depuis 1987. Devenue un lieu de mémoire spontané après la mort de la princesse Diana, elle rappelle que la statue de la Liberté, au-delà de son message politique, est aussi un symbole d’émotion et de rassemblement.
La Statue de la Liberté, Parisienne à jamais
Depuis son inauguration, la statue de la Liberté n’a cessé d’inspirer artistes, écrivains et cinéastes. Elle apparaît dans des centaines de films, de romans, de chansons, tantôt comme symbole d’espoir, tantôt comme témoin silencieux des bouleversements du monde. En 1927, elle est classée monument national par les États-Unis, et en 1984, elle entre au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Mais derrière son image universelle, la statue de la Liberté demeure, pour qui sait regarder, une Parisienne de cœur. Elle incarnera encore longtemps, espérons-le, les valeurs d'humanité et de partage, la capacité à rêver grand, à offrir au monde des chefs-d’œuvre qui traversent les océans et les siècles.
Accédez gratuitement à la carte et aux contenus supplémentaires
En créant votre compte gratuit, vous pourrez débloquer l’ensemble des fonctionnalités et des anecdotes, sans aucune limitation.
Déjà membre ? connectez-vous ici
25 rue de Chazelles, 75017 Paris
Vue carte
Vue satellite



Gérez vos favoris et accédez gratuitement à toutes les fonctions du site !
En créant votre compte, vous pourrez aussi accéder à l’ensemble des photos et articles, sans aucune limitation.
Déjà membre ? connectez-vous ici
Ou continuez en cliquant sur les icônes
5 fiches accessibles par jour, par catégorie, pour les non-membres